L'exposition
Le temps de pose
Pour rappel, nous avons vu dans l’introduction que pour gérer l’exposition d’une image, un appareil de prise de vue peut jouer sur 3 paramètres :
- Le temps de pose.
- L’ouverture
- La sensibilité.
Dans cet article, nous allons nous intéresser au temps de pose.
S’il ne fallait retenir que cela :
Le temps de pose est la durée pendant laquelle le capteur va rester exposé à la lumière lors d’une prise de vue. Plus la luminosité de la scène sera faible et plus on devra augmenter la durée d’exposition. En contrepartie, ceci va augmenter le risque que la photo soit floue. Le choix du temps de pose sera donc un compromis entre les conditions d’éclairage et le mouvement du photographe et/ou du sujet.
Explications :
Comme on vient de la voir, le temps de pose (que l’on pourra également nommer temps d’exposition ou temps d’ouverture) représente la durée pendant laquelle le capteur reste exposé à la lumière. On imagine bien de manière intuitive que plus le capteur reste exposé pendant longtemps, plus il va recevoir de lumière. On peut faire l’analogie avec un verre d’eau : plus longtemps le robinet restera ouvert, plus le verre se remplira (si on ne change pas le débit d’eau, bien entendu).
Vous entendrez sans doute parler à un moment ou à un autre de vitesse d’ouverture ou de vitesse d’obturation. Il s’agit du même concept que le temps de pose. J’éviterai néanmoins de l’employer afin d’éviter certaines confusions car temps et vitesse fonctionnent à l’inverse (diminuer le temps de pose équivaut à augmenter la vitesse).
Rappel pour les moins matheux :
Si comme beaucoup vous êtes allergiques aux chiffres, il est nécessaire de faire un rapide rappel de maths. Lorsque les temps de pose sont des fractions de seconde (1/2 s, 1/400 s…), plus le chiffre de droite est grand, plus le temps de pose est court. Une pose de 1/800 s est donc beaucoup plus courte qu’une pose de 1/5 s.
Exemple de photos à différentes expositions :
La série ci-dessous montre 4 photos :
- La première a été prise en mode automatique en laissant l’appareil choisir le temps de pose adapté. On voit que l’image est correctement exposée.
- Sur la deuxième, tous les paramètres ont été laissés à l’identique, sauf le temps de pose qui a été divisé par 2. La photo est donc beaucoup plus sombre car la quantité de lumière reçue a bien évidemment été divisée par 2. On dit qu’elle est « sous-exposée ». Si vous avez lu le post sur l’exposition, vous savez même qu’elle est sous exposée de 1 EV.
- Les 2 images suivantes sont la suite logique des premières, le temps de pose étant à chaque fois divisé par 2. L’image s’assombrit encore, au point que certaines zones sombres sont devenues totalement noires. On dit que les ombres sont « bouchées».
Par rapport à la référence, le temps de pose de la dernière image est divisé par 8 (entre 1/500° et 1/4.000° s). Elle est donc sous-exposée de 3 EV (23 = 2 x 2 x 2 = 8)




Comment est géré le temps d'exposition : l'obturateur
Nous avons tous vu ces images des photographes du début du XX° siècle retirant un capuchon de l’objectif de leur appareil photo puis le remettant en place. L’intervalle de temps entre ces 2 actions correspondait au temps de pose. Bien entendu, ce procédé était assez archaïque ! Depuis, la technologie a progressé et quelques décennies plus tard, les appareils se sont dotés d’obturateurs mécaniques. Il en existe de plusieurs types mais le plus répandu est l’obturateur de plan focal. Il est composé de 2 rideaux superposés (sur l’animation ci-dessous, le 1° rideau est noir alors que le second est gris). Selon le temps d’exposition choisi (long, moyen ou court), les deux rideaux s’ouvrent et se ferment de manière synchronisée, exposant le capteur à la lumière pendant la durée voulue.
Depuis quelques années, on voit apparaître des obturateurs électroniques. Avec ceux-ci, le capteur est exposé en permanence à la lumière. Lors du déclenchement, un signal électronique active le capteur pour une durée égale au temps de pose. Une fois celui-ci atteint, le capteur cesse l’enregistrement. Ils présentent l’avantage de permettre un déclenchement silencieux.
Cliquez sur les images pour voir l’animation.
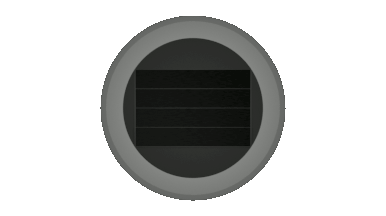
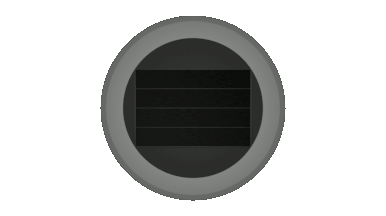
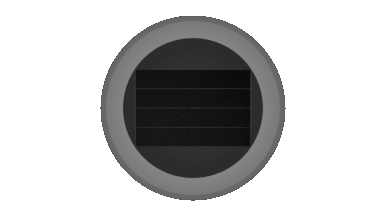
Les plages de vitesse d'obturation :
Pour s’adapter aux différentes conditions de luminosité (qui peuvent varier dans un rapport 1 à plusieurs millions selon entre le jour et la nuit), le temps d’exposition doit pouvoir varier dans des proportions importantes. Lorsque la lumière est forte, il est possible d’utiliser des temps de pose très courts, de 1/4.000° voire même 1/8.000° de seconde ! Autant dire qu’ils sont totalement imperceptibles. A l’inverse, lorsque la lumière vient à manquer, il est possible de d’utiliser des temps de pose de plusieurs secondes. La plupart des appareils permettent de monter à 30s. Il existe même un mode « bulb » permettant à l’utilisateur d’appuyer sur le déclencheur pour commencer l’exposition puis de le presser à nouveau pour la terminer. On peut ainsi prolonger l’exposition aussi longtemps qu’on le souhaite.
Les limites du mode automatique : Le flou de bougé ou de mouvement
On voit donc que l’appareil photo est capable de choisir un temps de pose adapté à toutes les situations d’exposition. Mais s’il est capable de mesurer finement la lumière, il ne sait pas (encore ?) comprendre le contexte de la prise de vue. Ceci peut donc mener à des mauvais choix.
Imaginons que nous prenions une photo en tout début ou fin de journée, alors que la luminosité est encore faible. Pour avoir suffisamment de lumière, l’appareil va déterminer (par exemple) un temps de pose de 1 s. Essayez maintenant de rester rigoureusement immobile pendant 1 s. Cela paraît simple, mais c’est impossible. Même sans boire (trop) de café, nous sommes en permanence animés d’infimes tremblements. S’ils sont imperceptibles, ils sont suffisants pour faire légèrement bouger l’appareil et obtenir une photo floue (voir un exemple d’image ci-dessous). On appelle ça le flou de bougé.



On considère en général que le flou de bougé risque de survenir pour des temps de pose supérieurs au 1/50 s. Heureusement, de nombreux appareils et caméras sont équipés de dispositifs de stabilisation (il existe différentes techniques plus ou moins efficaces) qui permettent de compenser jusqu’à un certain point les mouvements intempestifs.
Lorsque j’ai pris les photos de l’exemple ci-dessus, j’ai utilisé différents temps de pose compris entre 1/100 et 1/2 s, sans précaution particulière Le flou commençait à apparaître à 1/10 s. Avec un peu d’expérience, on peut ainsi imaginer d’utiliser des temps de pose de 1/10 voire 1/5 s et obtenir une photo raisonnablement nette.
Il existe différentes techniques pour limiter ce flou de bougé (la plus efficace étant l’utilisation d’un trépied). Elles seront présentées dans un article séparé afin de ne pas trop rallonger celui-ci (qui est déjà très long).
Un autre cas de figure peut apparaître même avec des temps de pose plus courts. Si nous prenons une photo au 1/50 s avec un appareil stabilisé, nous ne risquons pas le flou de bougé. Par contre, il peut y avoir des éléments mobiles dans la scène que nous photographions : des passants, des enfants qui courent, des sportifs en pleine action, des voitures… Prenons la encore un exemple, celui d’une voiture roulant en ville à 50 km/h. A cette vitesse elle effectue près de 14 m chaque seconde, soit environ 30 cm pendant le temps très bref où le capteur est exposé. Si ce véhicule est proche de nous, ce déplacement de 30 cm sera suffisant pour qu’il apparaisse légèrement flou. C’est ce qu’on appelle le flou de mouvement. Bien entendu, il sera d’autant plus important que la vitesse de l’objet (ou de la personne) sera grande.
La série d’image ci-dessous a été prise près de chez moi dans une « zone 30 » (la 2° colonne est un zoom sur les roues). Les voitures sont donc censées rouler lentement. On voit bien que plus le temps de pose est élevé, plus les véhicules sont flous. Vous pouvez cliquer sur les images pour les agrandir.
N.B : j’espère que les conducteurs ne m’ont pas aperçu car la vision d’une personne cachée derrière des buissons avec un appareil photo peut causer quelques frayeurs :-).
Sortir du mode automatique : le mode priorité vitesse.
Comment faire pour éviter ces situations de flou ? Comme nous l’avons vu plus haut, elles sont dues au fait que l’appareil n’a pas compris que la scène contenait des objets en mouvement. Il a donc choisi un temps de pose trop long. Pour régler ce problème, il suffit simplement d’expliquer (gentiment) à notre appareil qu’il doit raccourcir le temps d’exposition. Nous avons 2 possibilités à notre disposition :
- Le mode action. La plupart des appareils photo disposent de modes « scène« . Ils permettent à l’utilisateur d’indiquer le type de photo qu’il souhaite réaliser : un portrait, un paysage, un feu d’artifice… ou une scène d’action. L’appareil appliquera alors un jeu de paramètres prédéfinis par ses concepteurs et adapté au type de situation choisie. En sélectionnant le mode Action (ce nom peut varier d’une marque à une autre), le photographe indiquera à son appareil qu’il est face à des sujets en mouvement et qu’il doit utiliser un temps de pose court. Si elle est facile à mettre en œuvre, cette solution n’est pas très souple puisqu’elle n’adaptera pas finement le temps d’exposition à la vitesse du sujet.
 Pour les plus aventureux, le mode Priorité Vitesse. Il s’agit d’un des 2 modes semi-automatiques dont sont dotés la plupart des appareils dits « experts ». Comme son nom l’indique, il permettra à l’utilisateur de fixer le temps de pose (ou la vitesse) qu’il souhaite utiliser dans une situation donnée. L’appareil adaptera automatiquement les autres paramètres pour maintenir une exposition correcte (pour plus de détails, voir l’article sur le « triangle d’exposition »). Ce mode peut se nommer T (comme Time ou Temps… utilisé entre autres par Canon) ou S (comme Speed ou vitesse… utilisé entre autres par Sony comme dans l’exemple ci-contre).
Pour les plus aventureux, le mode Priorité Vitesse. Il s’agit d’un des 2 modes semi-automatiques dont sont dotés la plupart des appareils dits « experts ». Comme son nom l’indique, il permettra à l’utilisateur de fixer le temps de pose (ou la vitesse) qu’il souhaite utiliser dans une situation donnée. L’appareil adaptera automatiquement les autres paramètres pour maintenir une exposition correcte (pour plus de détails, voir l’article sur le « triangle d’exposition »). Ce mode peut se nommer T (comme Time ou Temps… utilisé entre autres par Canon) ou S (comme Speed ou vitesse… utilisé entre autres par Sony comme dans l’exemple ci-contre).
Temps de pose indicatifs en fonction de la situation :
- Personne ou animal bougeant à vitesse normale : 1/250° s
- Personne ou animal bougeant à vitesse rapide (un athlète, mon jeune neveu…) : 1/500° s. En ce qui concerne mon neveu, je me demande parfois dans quelle catégorie le classer : personne ou animal 🙂
- Avion, voiture ou moto : 1/1000° s
- Oiseau en vol : 1/2000° s
Cas particulier : la vidéo
En vidéo, le temps de pose est un paramètre qui change généralement peu. Il y a 2 raisons à cela :
- Tout d’abord, une vidéo est une succession rapide d’image. La cadence de prise de vue varie légèrement selon les normes, mais on retiendra pour simplifier qu’elle est de 25 images par seconde. Le temps de pose ne pourra donc pas dépasser 1/25s. Si l’on ajoute le temps nécessaire au traitement de chaque image et à son enregistrement sur la carte, on pourra donc difficilement monter au-dessus de 1/30 voire 1/40 s.
- Pendant longtemps, les caméras ont utilisé pour des raisons mécaniques des obturateurs en forme de disques qui « tournaient » deux fois plus vite que la pellicule. Comme le cinéma tourne en 25 images par seconde, les temps d’exposition étaient mécaniquement de 1/50 s. Ce temps de pose engendre un léger flou, mais il rend les mouvements fluides et agréables à l’œil. Comme nous sommes habitués à ce type de rendu, il est d’usage d’utiliser un temps d’exposition de 1/50 s (sinon l’effet risque de paraître déplaisant). Mais comme toute règle, celle-ci possède ses exceptions et un réalisateur averti pourra modifier cette durée pour obtenir l’effet désiré. L’exemple le plus connu est la scène du débarquement dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan » qui a été filmée à 1/200 s. Steven Spielberg voulait ainsi obtenir des mouvements plus saccadés, plus en phase avec le contexte dramatique.
Nous comprenons maintenant l’intérêt qu’il y a à faire varier le temps de pose. Il nous permet de nous adapter aux conditions de luminosité. Néanmoins, il est nécessaire de prendre en compte le contexte dans lequel nous évoluons (photo à main levée, sujets en mouvement) pour éviter les phénomènes de flou.